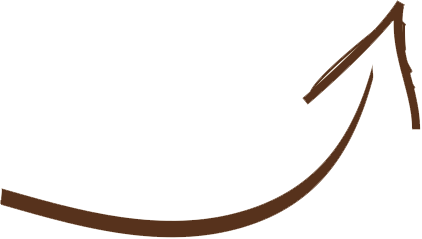Dans l’ancienne Brie française, sur un plateau entre les deux vallées où coulent la rivière d’Hyères et le ruisseau de l’Yvron, le château de Lagrange domine quelque peu le pays qui l’entoure. Aux temps féodaux, la seigneurie de La Grange-en-Brie est un ensemble vraisemblablement composé d’une tour rectangulaire, dont les vestiges sont aujourd’hui enfouis, de la chapelle Marie-Madeleine et de quelques maisons.
Photo : Johann Fournnier
La première trace écrite
conservée faisant mention
du lieu est un titre de droit
de pêche de 1176, époque
de Pierre Ier de Courtenay,
septième enfant de Louis
VI le Gros, qui donna trois
empereurs à Constantinople.
Un volumineux terrier
du XVIIIe inventorie les
documents légaux du château
depuis le XIVe. Il est la source
principale de la richesse de
cette histoire.
conservée faisant mention
du lieu est un titre de droit
de pêche de 1176, époque
de Pierre Ier de Courtenay,
septième enfant de Louis
VI le Gros, qui donna trois
empereurs à Constantinople.
Un volumineux terrier
du XVIIIe inventorie les
documents légaux du château
depuis le XIVe. Il est la source
principale de la richesse de
cette histoire.
Au début du XIVe siècle, Jeanne de Courpalay épouse Pierre de Courtenay dont les armoiries sont encore visibles au porche de la chapelle et au fronton sud du château. Les aléas des alliances, rentes, querelles et parfois ruines obligent Jean IV de Courtenay, seigneur de Bléneau, à reconstruire presque totalement la chapelle et le château à la fin du XVe siècle, pour en faire un fort massif, fermé, avec une double enceinte de fossés. Il est environné d’un petit village dévoué à l’agriculture. Au XVIe, la « dame de La Grange », Françoise de Courtenay fait l’acquisition de l’ensemble des terres de Courpalay.
Dans son état actuel, le
château se compose d’un
châtelet (porche encadré par
deux tours rondes et pont de
pierre) au nord, d’un corps
de logis à l’est flanqué d’une
troisième tour ronde, d’un
second corps de logis au sud,
d’une quatrième tour au sud,
à l’angle des deux corps de
logis, et d’une cinquième tour
à l’ouest à l’extrémité de l’aile
sud. Le tout forme un «U»
ouvert au nord-ouest.
château se compose d’un
châtelet (porche encadré par
deux tours rondes et pont de
pierre) au nord, d’un corps
de logis à l’est flanqué d’une
troisième tour ronde, d’un
second corps de logis au sud,
d’une quatrième tour au sud,
à l’angle des deux corps de
logis, et d’une cinquième tour
à l’ouest à l’extrémité de l’aile
sud. Le tout forme un «U»
ouvert au nord-ouest.
Au XVIIe, la terre de Lagrange s’attache à
une nouvelle illustre famille. La troisième
fille de Françoise de Courtenay, Jacqueline de
Lignières se marie à Georges d’Aubusson.
Le jeune ménage réassemble les différentes
terres perdues et améliore les environs.
une nouvelle illustre famille. La troisième
fille de Françoise de Courtenay, Jacqueline de
Lignières se marie à Georges d’Aubusson.
Le jeune ménage réassemble les différentes
terres perdues et améliore les environs.
L’aîné de leurs enfants prend la suite : François II
d’Aubusson, deuxième du nom, comte
de La Feuillade, baron de Pérusse, seigneurx de
Vouhet, de La Grange-Bléneau et de Courpalay-
en-Brie. Il est enfant d’honneur de Louis XIII,
rapidement maréchal de camp et devient le premier
chambellan de Gaston d’Orléans, frère du roi.
Plusieurs ouvrages font de La Grange, à cette
époque, une place forte de la Fronde, comme en
témoigne un impact de boulet sur la tour nord-est,
tir ordonné, dit-on, par Turenne.
d’Aubusson, deuxième du nom, comte
de La Feuillade, baron de Pérusse, seigneurx de
Vouhet, de La Grange-Bléneau et de Courpalay-
en-Brie. Il est enfant d’honneur de Louis XIII,
rapidement maréchal de camp et devient le premier
chambellan de Gaston d’Orléans, frère du roi.
Plusieurs ouvrages font de La Grange, à cette
époque, une place forte de la Fronde, comme en
témoigne un impact de boulet sur la tour nord-est,
tir ordonné, dit-on, par Turenne.
Des enfants de François II, c’est Léon qui
conservera le titre, puis François III d’Aubusson,
un sujet bien singulier et très brave dont
Mazarin disait qu’il était sans cervelle. En
recevant sa sixième blessure devant Landrecies,
il sera ramassé par les espagnols. Au chirurgien
qui le soigne, il précisera : « enlevez quelque
morceau de cervelle et l’envoyez au cardinal
pour lui apprendre que j’en ai. »
conservera le titre, puis François III d’Aubusson,
un sujet bien singulier et très brave dont
Mazarin disait qu’il était sans cervelle. En
recevant sa sixième blessure devant Landrecies,
il sera ramassé par les espagnols. Au chirurgien
qui le soigne, il précisera : « enlevez quelque
morceau de cervelle et l’envoyez au cardinal
pour lui apprendre que j’en ai. »
Devenu duc de La Feuillade,
François III d’Aubusson opéra
de nouveaux travaux, délaissant
l’aspect féodal pour le tracé actuel.
Le mur ouest est ouvert, laissant
le soleil couchant éclairer la cour
d’honneur. Le mur sud s’agrémente
d’un fronton grec.
Sans sucesseur, Louis, son fils,
abandonna quasiment La Grange,
qui ne l’hébergea jamais.
François III d’Aubusson opéra
de nouveaux travaux, délaissant
l’aspect féodal pour le tracé actuel.
Le mur ouest est ouvert, laissant
le soleil couchant éclairer la cour
d’honneur. Le mur sud s’agrémente
d’un fronton grec.
Sans sucesseur, Louis, son fils,
abandonna quasiment La Grange,
qui ne l’hébergea jamais.
Le conseiller du roi, directeur général des monnaies de France, Pierre Grassin, baron d’Arcis, fit l’acquisition du château en 1735. Il le céda ensuite à Louis Dupré, conseiller au parlement de Paris. Au milieu du XVIIIe, huit fermes et deux moulins composaient le revenu du domaine et celui-ci avait presque doublé.
La fille de M. Dupré épousa M. de Fresnes dont la fille, Henriette d’Aguesseau, épousa le duc d’Ayen, fils du maréchal de Noailles. Après la révolution française, Adrienne de Noailles, épouse Lafayette, reçut Lagrange en héritage avant même la restitution des biens confisqués aux émigrés.
Le château était dans un tel état d’abandon qu’Adrienne habita le temps des travaux menés par l’architecte Vaudoyer chez sa sœur, à Fontenay-Trésigny. Au retour de Lafayette en France en 1800, le couple y élit domicile. C’est couronné d’une gloire internationale, et avec l’image du grand gardien de la liberté, que Lafayette y développa l’agriculture, selon le mouvement impulsé par les Lumières. La chapelle se mua en grange et il fit redessiner le parc par Hubert Robert, supprimant les douves.
Il demeurait ainsi proche de la nature et ne restait pas trop loin de Paris. Après le décès d’Adrienne en 1807, Lafayette fait fermer ses appartements.
Le château était dans un tel état d’abandon qu’Adrienne habita le temps des travaux menés par l’architecte Vaudoyer chez sa sœur, à Fontenay-Trésigny. Au retour de Lafayette en France en 1800, le couple y élit domicile. C’est couronné d’une gloire internationale, et avec l’image du grand gardien de la liberté, que Lafayette y développa l’agriculture, selon le mouvement impulsé par les Lumières. La chapelle se mua en grange et il fit redessiner le parc par Hubert Robert, supprimant les douves.
Il demeurait ainsi proche de la nature et ne restait pas trop loin de Paris. Après le décès d’Adrienne en 1807, Lafayette fait fermer ses appartements.
Lafayette vivra à Lagrange entouré d’enfants et petits-enfants jusqu’à sa mort en 1834.
Sa fille Virginie et son mari, Louis de Lasteyrie, héritent du site qu’ils occupent déjà. Puis tout au
long du XIXe siècle, les trois générations suivantes de Lasteyrie, unies par alliances à de grandes
familles britanniques y habiteront. Les Rohan-Chabot apportant l’échos d’héritages irlandais :
Leinster, Ormond, Llandaff ; les Goodlake, ceux des Baker, Mills ou FitzGerald.
Sa fille Virginie et son mari, Louis de Lasteyrie, héritent du site qu’ils occupent déjà. Puis tout au
long du XIXe siècle, les trois générations suivantes de Lasteyrie, unies par alliances à de grandes
familles britanniques y habiteront. Les Rohan-Chabot apportant l’échos d’héritages irlandais :
Leinster, Ormond, Llandaff ; les Goodlake, ceux des Baker, Mills ou FitzGerald.
En 1935, Louis III de Lasteyrie céda en viager le château à son cousin, René de Chambrun, lui-même descen-
dant de Lafayette. Celui-ci y découvrit un impressionnant fonds d’archives qu’il entreprit de mettre en ordre.
Conscient de l’importance considérable du patrimoine en sa possession, il décide d’en assurer l’indépendance, la
neutralité et la pérennité, en l’abritant au sein d’une Fondation d’utilité publique qui verra le jour en 1959.
dant de Lafayette. Celui-ci y découvrit un impressionnant fonds d’archives qu’il entreprit de mettre en ordre.
Conscient de l’importance considérable du patrimoine en sa possession, il décide d’en assurer l’indépendance, la
neutralité et la pérennité, en l’abritant au sein d’une Fondation d’utilité publique qui verra le jour en 1959.
Photo : Johann Fournnier