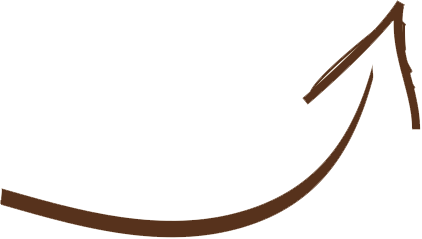
Le château de Châteldon est un ensemble fortifié de bâtiments
dont la vie épouse l’histoire locale.
Le granit des sols, l’humidité du climat ont façonné le terrain pentu sur lequel le château
joue son rôle de poste de garde. Depuis ses 280 mètres d’altitude, il sépare le Bourbonnais,
le Forez et l’Auvergne du Sud.
dont la vie épouse l’histoire locale.
Le granit des sols, l’humidité du climat ont façonné le terrain pentu sur lequel le château
joue son rôle de poste de garde. Depuis ses 280 mètres d’altitude, il sépare le Bourbonnais,
le Forez et l’Auvergne du Sud.
Quelques signes de présence néolithique et la
vraisemblable occupation romaine désignent un
terrain favorable. Le document le plus ancien
conservé, daté d’août 1200, évoque la présence
d’Archambaud, seigneur de Saint-Géran. Il débute
une suite de propriétaires héritiers durant la période
du Moyen-Âge, faste pour la petite ville. Celle-ci
initie l’industrie coutelière qui fera la renommée du
pays, participe à en faire la première région viticole
de France et demeure sans égale quant à la richesse
de ses eaux.
vraisemblable occupation romaine désignent un
terrain favorable. Le document le plus ancien
conservé, daté d’août 1200, évoque la présence
d’Archambaud, seigneur de Saint-Géran. Il débute
une suite de propriétaires héritiers durant la période
du Moyen-Âge, faste pour la petite ville. Celle-ci
initie l’industrie coutelière qui fera la renommée du
pays, participe à en faire la première région viticole
de France et demeure sans égale quant à la richesse
de ses eaux.
S’y construisent le corps de bâtiment nord, assis
sur de grandes caves, une tour carrée, retravaillée
au XIXe, trois tours circulaires, dont l’une abrite
la chapelle, couverte de fresques commandées par
Jean-Aubert Aycelin de Montaigu,
évêque de Clermont.
sur de grandes caves, une tour carrée, retravaillée
au XIXe, trois tours circulaires, dont l’une abrite
la chapelle, couverte de fresques commandées par
Jean-Aubert Aycelin de Montaigu,
évêque de Clermont.
Au XIVe siècle, Gilles II Aycelin de Montaigu
fait construire la première enceinte. C’est aussi
l’époque de la construction du second pont sur
l’Allier et du marché hebdomadaire, mais aussi
de la peste en 1348.
De cette période à la Révolution, le territoire est
une enclave appartenant au Bourbonnais.
En 1433, le propriétaire, Rodrigue de
Villandrando, se distingue héroïquement en
repoussant une attaque anglaise, l’événement
est conservé par une chanson dans la mémoire
populaire.
De nombreux travaux seront réalisés au XVe
siècle par Philippe de Vienne puis Jean de
Vienne. Au XVIe siècle un La Fayette y vit avec
l’héritière son épouse.
fait construire la première enceinte. C’est aussi
l’époque de la construction du second pont sur
l’Allier et du marché hebdomadaire, mais aussi
de la peste en 1348.
De cette période à la Révolution, le territoire est
une enclave appartenant au Bourbonnais.
En 1433, le propriétaire, Rodrigue de
Villandrando, se distingue héroïquement en
repoussant une attaque anglaise, l’événement
est conservé par une chanson dans la mémoire
populaire.
De nombreux travaux seront réalisés au XVe
siècle par Philippe de Vienne puis Jean de
Vienne. Au XVIe siècle un La Fayette y vit avec
l’héritière son épouse.
Le commandant Rodrigue de Villandrando déconfit les anglais sous les murs de Châteldon.
Début XVIIIe, c’est Elizabeth de Rohan qui en aura la possession. Les remparts sud et
ouest sont ouverts. Les propriétaires suivants seront successivement ruinés. Forcé par
le système Law, Joachim de Fayn de Rochepierre cède le château à Pierre Lauvergne
puis il sera revendu à André Hébert, ancien gouverneur de Pondichéry qui démolit
les combles, réaménage l’ensemble et son jardin, et décide de transformer plusieurs
proches vallées en rizières. Elles ne produiront qu’une épidémie.
Obligé d’indemniser les malades, il vend ses biens à Jean-Claude Douet qui offre la
possibilité à Lavoisier de passer quelques temps au château pour implanter la culture
du tabac. L’idée est interrompue dans le sang par le tribunal révolutionnaire et les
biens deviennent nationaux.
ouest sont ouverts. Les propriétaires suivants seront successivement ruinés. Forcé par
le système Law, Joachim de Fayn de Rochepierre cède le château à Pierre Lauvergne
puis il sera revendu à André Hébert, ancien gouverneur de Pondichéry qui démolit
les combles, réaménage l’ensemble et son jardin, et décide de transformer plusieurs
proches vallées en rizières. Elles ne produiront qu’une épidémie.
Obligé d’indemniser les malades, il vend ses biens à Jean-Claude Douet qui offre la
possibilité à Lavoisier de passer quelques temps au château pour implanter la culture
du tabac. L’idée est interrompue dans le sang par le tribunal révolutionnaire et les
biens deviennent nationaux.
Le riche décor de la chapelle occupe quasiment l’ensemble des murs.
Hormis les scènes habituelles de la vie du Christ, le regard du visiteur
peut s’attacher à la légende de Sainte-Marguerite d’Antioche.
Hormis les scènes habituelles de la vie du Christ, le regard du visiteur
peut s’attacher à la légende de Sainte-Marguerite d’Antioche.
Au XIXe siècle, les propriétaires s’y succèdent rapidement. L’aile est se voit ajouter
un porche de brique polychrome et une serre. En 1931, le château est acquis par
Pierre Laval, Président du Conseil et enfant du pays. Il est aujourd’hui la propriété
de la Fondation Chambrun.
un porche de brique polychrome et une serre. En 1931, le château est acquis par
Pierre Laval, Président du Conseil et enfant du pays. Il est aujourd’hui la propriété
de la Fondation Chambrun.
La Fondation a aussi acquis deux vieilles demeures à colombages des XVe et XVIe siècles au cœur du village.
L’une d’elles permet à la municipalité d’y accueillir des auteurs en résidence et d’y programmer des expositions.
L’une d’elles permet à la municipalité d’y accueillir des auteurs en résidence et d’y programmer des expositions.
En 2015, la Fondation a diligenté un rapport
d’étude de la chapelle du château, au cœur de
la tour la plus ancienne, du XIIIe siècle. Elle
a permis de révéler la beauté et la finesse de
l’ensemble des fresques. On y retrouve des scènes
religieuses traditionnelles mais aussi la vie de
Sainte Marguerite d’Antioche. La fondation
a pour projet de préparer la restauration
de ce précieux ensemble.
d’étude de la chapelle du château, au cœur de
la tour la plus ancienne, du XIIIe siècle. Elle
a permis de révéler la beauté et la finesse de
l’ensemble des fresques. On y retrouve des scènes
religieuses traditionnelles mais aussi la vie de
Sainte Marguerite d’Antioche. La fondation
a pour projet de préparer la restauration
de ce précieux ensemble.
Photo : J.F. Pazyniak
www.chateldon.com