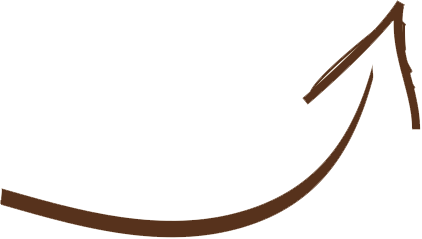
Dans la nuit du 20 juin 1791, au nez et à la barbe de Lafayette, la famille royale s’échappe des tuileries. Alors qu’il inspectait ses gardes après avoir assisté au coucher du roi, Lafayette a croisé Marie-Antoinette sans la remarquer. Il dort encore lorsque qu’on le tire de son lit pour l’avertir de la fuite royale.
Messe de la famille royale dans la Galerie de Diane, au château des Tuileries.
Sabre de la Garde
nationale à l’effigie
de Lafayette
La Garde nationale de Lafayette tire sur le rassemblement qui amène la pétition pour la « République »
des Cordeliers à l’autel de la patrie, fusillade du 17 juillet 1791 au champ-de-mars.
Anonyme, 1791, Paris Musées/Musée Carnavalet
Une personnification de la France où la monarchie frappe à coups de massue Lafayette.
Paris Musées/Musée Carnavalet
Accusé de complicité — alors qu’il avait donné sa parole que Louis XVI ne s’échapperait pas —
il est menacé, insulté et bafoué par la foule qui le suit de près
tandis qu’il rejoint le Carrousel en compagnie de Bailly, maire de Paris. Estimant que le roi a rompu le pacte qui l’unissait à la nation, Lafayette prend sur lui de dicter son arrestation et celle de sa famille :
« Les ennemis de la Révolution enlevant le roi, le porteur est chargé d’avertir tous les bons citoyens : il leur est enjoint, au nom de la patrie en danger, de le tirer de leurs mains et de le ramener au sein de l’Assemblée nationale. Elle va se réunir, mais en attendant, je prends sur moi toute la responsabilité du présent ordre. Paris, le 21 juin 1791. »
G. Lenotre, Le Drame de Varennes, Paris, Perrin, 1905
Un mois plus tard et un an après avoir juré fidélité à la nation, à la loi et au roi sur l’autel de la Patrie, la Garde nationale, tire sur les patriotes venus au Champ-de-Mars pour répondre à l’appel de la pétition qui demande le jugement de Louis XVI et l’organisation d’un nouveau pouvoir exécutif.
Accusé d’avoir voulu imposer l’ordre par la terreur, Lafayette démissionne le 8 octobre de la Garde nationale et se retire sur ses terres auvergnates.
Deux mois plus tard, désigné par le roi, Lafayette quitte Chavaniac pour prendre le commandement de l’armée du Centre.
« Les Jacobins excitèrent, le 17 juillet, une émeute considérable. Les brigands commencèrent par massacrer deux hommes. La loi martiale fut proclamée. Il est difficile de se faire une idée de l’état d’angoisse de ma mère, pendant que mon père était au Champ de Mars, en butte à la rage d’une multitude furieuse qui se dispersa en criant qu’il fallait assassiner ma mère et porter sa tête au devant de lui. Je me rappelle les cris affreux que nous entendîmes, l’effroi de chacun dans la maison, et par-dessus tout la vive joie de ma mère, en songeant que les brigands qui arrivaient n’étaient plus au Champ de Mars. Elle nous embrassait en pleurant de joie et prenait, dans ce danger pressant, les précautions nécessaires avec un calme et surtout un soulagement bien grands. On avait doublé la garde, qui se mit en bataille devant la maison ; mais les brigands furent au moment d’entrer chez ma mère, par le jardin qui donnait sur la place du Palais-Bourbon et dont ils escaladaient le petit mur, lorsqu’un corps de cavalerie, qui passait sur la place, les dispersa. La Constitution ayant été acceptée par le roi, l’Assemblée constituante termina ses séances elle fut remplacée par l’Assemblée législative. Mon père quitta la garde nationale et partit, avec ma mère, au commencement d’octobre, pour l’Auvergne. »
Vie de Madame de Lafayette par Mme de Lasteyrie sa fille, Paris,
Léon Techener fils, 1868
Quatre plaques
de Palloy frappées
en mémoire de la
prise de la Bastille
Médaille en négatif
au profil de Lafayette
commandant de
la Garde nationale
parisienne
Médaille en négatif
au profil de Lafayette
commandant de
la Garde nationale
parisienne
Le Temple où la dernière prison où
le roi et sa famille furent enfermés
à partir du 10 août 1792.
Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à
l’Autriche et à la Prusse. « La déclaration de guerre
fut suivie de plusieurs combats à l’armée de mon
père, dans l’un desquels M. de Gouvion, ancien major
général de la garde nationale, fut tué. Ma mère était
pénétrée de terreur et poursuivie des plus affreux
pressentiments ; les troubles de l’intérieur ajoutaient à
son effroi. La lettre de mon père à l’Assemblée légis-
lative (lettre écrite du camp de Maubeuge le 16 juin
1792) contre les Jacobins et son apparition à la barre
pour la soutenir, mêlèrent à ses tourments toutes les
jouissances qu’elle était accoutumée à trouver dans sa
conduite. Mais vous comprenez ce qu’elle souffrait à
cette distance, en le voyant exposé à tant de dangers
différents. Il l’engagea à venir le joindre ; elle craignit
que dans l’effervescence des esprits, son déplacement
ne servît de prétexte aux calomnies, et qu’on ne préten-
dît qu’il voulait mettre sa famille à l’abri ; elle avait
peur aussi de gêner ses marches, qui dépendaient de
tant d’événements incertains. Après quelques jours de
délibération, elle résolut de se sacrifier et de rester à
Chavaniac. Un groupe de volontaires de la Gironde,
qui rejoignait l’armée, passa dans le village vers ce
temps ; ils étaient fort exaltés, quelques-uns même
parlaient de brûler le château. Ma mère donna à dîner
aux officiers, fit nourrir le détachement qui logeait
dans le village, et sa manière noble et patriotique ins-
pira du respect et préserva de tout accident. Peu après
que ma mère eut pris la généreuse résolution de rester
à Chavaniac, elle apprit l’insurrection du 10 août. Elle sut, presque en même temps, que mon grand-père, qui était aux Tuileries pour défendre le roi, ainsi que mon oncle, M. de Grammont, que l’on chercha parmi les morts, avaient tous deux échappé aux dangers de cette affreuse journée. Les journaux donnaient les détails de la résistance de mon père à Sedan. On vit bientôt que tout était inutile, et rien n’est comparable aux angoisses de ma mère pendant les jours qui suivirent. Les gazettes étalent pleines de décrets sanguinaires auxquels on se soumettait partout, excepté sur le point ou mon père commandait. On mit sa tête à prix. On vint promettre à la barre de l’Assemblée de l’amener mort ou vif. Enfin, le dimanche 24 août, elle reçut une lettre de sa sœur, Mme de Noailles, qui lui apprit que mon père était hors de France. L’ivresse de la joie de ma mère fut égale à son désespoir des jours précédents... Ma mère mit ordre à tout, brûla ou cacha ses papiers, puis, d’après les avis alarmants qu’elle recevait, résolut de placer ses enfants en sûreté. Un curé assermenté vint lui offrir un asile dans la montagne. M. Frestel y conduisit mon frère dans la nuit. Elle nous fit partir dès le soir-même pour Langeac, petite ville à deux lieues de Chavaniac, et âpres avoir ainsi pourvu à tout, elle attendit en paix ce qui lui arriverait. Elle resta près de ma tante, à qui il eût été impossible de persuader de quitter le château. »
Vie de Madame de Lafayette par Mme de Lasteyrie sa
fille, Paris, Léon Techener fils, 1868
En juin, Lafayette quitte son armée et se rend à Paris pour protester contre les débordements jacobins. Il supplie l’Assemblée de faire respecter son autorité et celle du roi et regagne son armée à Metz. Les Jacobins lui reprochent aussitôt d’avoir déserté.
Le 10 août, la foule déchaînée envahit les Tuileries. Le roi se réfugie à l’Assemblée où il est suspendu de ses fonctions. La monarchie constitutionnelle disparaît. La Terreur s’installe.
Note de Lafayette sur Robespierre
Poussé par les événements, Lafayette, alors commandant de l’armée du Nord, quitte volontairement la France avec son état-major dans la nuit du 19 août.
Départ de Lafayette du camp de Sedan
Retour de la famille royale à Paris le 25 juin 1791, après la fuite à Varennes. Gravure coloriée, Musée Carnavalet, Paris.