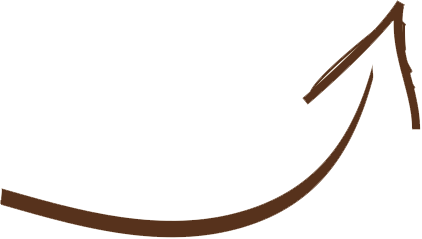
Discours du Roi prononcé
à l’assemblée des notables,
du lundi 23 avril 1787 ;
suivi du Mémoire de M. le
Marquis de la Fayette.
Revenu à sa vie mondaine l’esprit brûlant d’égalité civique, de souveraineté nationale, de refus des privilèges et d’affirmation des droits de l’homme, Lafayette s’apprête à quitter de nouveau la France pour rencontrer Catherine II en Russie. Convoqué à Versailles par Louis XVI le 22 février 1787, IL RENONCE À SON DÉPART ET ASSISTE À L’ASSEMBLÉE DES NOTABLES.
La première assemblée des notables, qui se tint dans
la salle des Menus-Plaisirs à Versailles du 22 février
au 23 mai 1787, était chargée de trouver des solutions
à la grave crise financière qui menaçait le royaume.
Dans ce discours, le roi répond favorablement
aux projets de réforme fiscale : fin des exemptions
du clergé et suppression de la gabelle. Il envisage
également les économies que doit faire l’État tout en
assurant le remboursement de la dette.
Lafayette vient appuyer le
discours du roi en dénonçant plus
particulièrement l’agiotage des
terres, une pratique spéculative
aux conséquences néfastes, et la
mauvaise administration
des biens du Roi.
D’abord rayé par le roi, le nom de Lafayette apparaît à nouveau sur la liste des douze douzaines de notables les plus importants du royaume convoqués à l’assemblée. Il leur est demandé de réfléchir aux moyens de faire face à la crise des finances.
LAFAYETTE, QUI SIÈGE AUX DEUX ASSEMBLÉES DE 1787 ET 1788, dénonce avec vigeur les scandales financiers et la surimposition du peuple, réclame la réunion des États généraux et se prononce en la faveur du doublement de la représentation du tiers-état.
Deux hommes
en uniforme du
régiment des
Gardes françaises
de Louis XVI
en 1786
Procès verbal des séances
de l’assemblée provinciale
d’Auvergne tenue à
Clermont-Ferrand dans le
mois de Novembre 1787
Clermont-Ferrand,
Antoine Delcros, 1787
Miniature représentant les enfants de Lafayette autour du buste de leur père. Anastasie, née en 1777, George-Washington, né en 1779 et Virginie, née en 1782.
Déjà très remarqué à l’assemblée des notables, Lafayette s’illustre dans cette assemblée provinciale qui le met aux prises avec une autre réalité politique. Il domine les débats dans sa région natale ce qui appuie son esprit d’opposition. La réussite de cette étape lui permettra de se défendre au mieux à Versailles. Cette jolie reliure aux armes renforce l’importance de cet épisode.
En relation depuis 1786 avec les abolitionnistes anglais Thomas Clarkson, Granville Sharp et William Wilberforce, qui fondèrent la Société de l’abolition de la traite des noirs, LAFAYETTE ET ADRIENNE ADHÈRENT EN 1787 À LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES NOIRS que fonde Brissot et où ils retrouvent un certain nombre de leurs amis libéraux.
Clarkson a sillonné les ports et interrogé les témoins pour écrire ce qui est peut-être L’OUVRAGE ABOLITIONNISTE LE PLUS INFLUENT. Il contient notamment une célèbre planche représentant les plans du Brookes, un navire à esclaves de Liverpool, qui réussit à installer le débat sur le terrain moral. La bibliothèque personnelle de Lafayette compte plusieurs références à ce mouvement. L’ouvrage comporte un envoi de l’auteur à son « friend Lafayette ».
Thomas Clarkson, The History of the rise, progress, and accomplishment of the abolition of the African slave-trade by the British Parliament, London, Longman..., 1808
Jean Hector Saint-John de Crèvecœur, Lettres d’un cultivateur américain..., Paris, Cuchet, 1787
Première traduction, largement augmentée et dédiée à Lafayette, de ce texte publié originellement en 1782 à Londres et dédié à l’abbé Raynal. L’auteur, un normand, engagé au Canada puis installé aux Etats-Unis, y décrit de façon élogieuse la vie des premiers américains avec de nombreux détails et particulièrement le rapport à la nature. Cela conduisit de nombreux français à émigrer, avec des fortunes bien moindres. Il présente aussi les idéaux de diversité religieuse, de creuset de population et d’abolitionnisme. A ce titre, cet ouvrage peut être considéré comme la première description du « rêve américain ». La version française ajoute de très nombreux éléments émotionnels afin d’agir sur les consciences. La même année, Crèvecœur fonde avec
Brissot la Société gallo-américaine, à intérêts commerciaux, puis la Société des Amis des Noirs. Seront présents aux deux notamment :
Benjamin Franklin,
Thomas Paine,
Condorcet et Lafayette.
Image extraite du film Marie-Antoinette reine de France réalisé par Jean Delannoy
« Lafayette a conscience de l'opposition
entre la force qui naît et celle qui décline...
Il s’associe à la ferme protestation de la noblesse de Bretagne, et la cour s’indigne de trouver partout, en face d’elle, ce même adversaire qui pourtant est sorti de ses rangs. Marie-Antoinette lui fait reprocher son attitude. Pourquoi a-t-il signé la protestation des nobles de Bretagne, alors qu’il n’est pas Breton ? Brutal, il lui fait répondre : je suis Breton de la même manière que la Reine est d’Autriche.
Le roi lui retire ses lettres de service de maréchal de camp. Lafayette est quelque
peu décontenancé : il ne s’attendait pas à de telles représailles, la certitude de n’avoir fait que son devoir n’atténue pas le regret d’avoir perdu un commandement auquel il était persuadé qu’on n’oserait toucher.
Pendant quelques semaines il a espéré
et craint tout ensemble que le roi le
ferait embastillé, comme rançon de son indépendance.
Mais, pressé par les nécessités financières et par les rumeurs d’une opinion inquiète, le roi convoque les États Généraux ! »
Jacques Kayser, La vie de Lafayette, Paris, Gallimard, 1928
Depuis son retour des États-Unis, Lafayette ne compte plus ses engagements, ses déplacements, ses investissements, pas plus qu’il ne s’attarde sur l’état de ses finances.
Son intendant, Morizot, lui envoie le relevé des dépenses faites entre juin 1787 et 1788 et l’assortit de QUELQUES COMMENTAIRES DESTINÉS À LE RAPPELER À L’ORDRE : « Je vous supplie de le méditer et vous reconnaîtrez que dans les 75081 livres que vous avez mangées sur vos fonds, il y en a 70 qui ne peuvent regarder que vous seul. En effet, Monsieur le marquis, les 3e et 4e colonnes relatives à votre personne vont à 60 mille francs et elles ne devaient faire que 15. La maison et les enfants s’élèvent à 40, et ne devaient aller qu’à 25, c’est un autre excédent de 15, et la cause vient de la table de Clermont et de ce que les dîners à Paris ont été trop multipliés. Vient ensuite l’écurie. Elle n’a surpassé d’au moins 10000 livres qu’à cause des voitures et chevaux que vous avez achetés et qu’à cause, surtout, des fréquentes occasions de travail que vos voyages et vos courses ont fournies aux ouvriers.
Ah combien j’ai eu raison, Monsieur le marquis, de vous représenter que l’ordre dans votre maison et dans vos finances
ne dépendait que de vous uniquement ! A la vérité, il est possible de réformer quelques abus parmi vos gens, mais jamais la plus grande surveillance ne vous vaudra cent louis. J’ose le répéter, cet arrangement heureux, qui fait que l’on ne dépense que ses revenus et qu’on transmet à ses enfants les biens qu’on a reçus de ses pères, ne peut venir que de vous. »
LE RELEVÉ DES DÉPENSES NOUS APPREND, entre autres choses, que :
- Alors que Lafayette a dépensé 52284 livres pour l’année, Adrienne n’en a dépensé que 9480 ;
- Les enfants ont une gouvernante anglaise ou américaine qui s’appelle Miss Carter ;
- Les enfants ont été « inoculés » pour 2120 livres (Lafayette croyait donc déjà aux vaccins, ils n’existaient que contre
la petite vérole) ;
- Lafayette a dépensé en un an 3215 livres de tailleur, 138 de dentelles, 228 de bottier et 450 livres d’opéra.