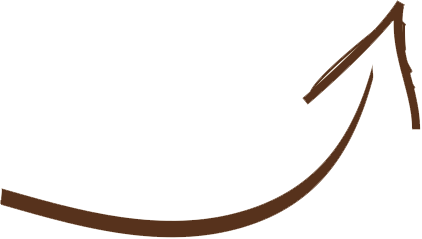
En juin 1784, invité par Washington, Lafayette embarque pour les États-Unis. Reçu comme un ami à Mount Vernon, il y passe cinq mois. Il évoque librement des sujets comme l’abolition de l’esclavage ou le mesmérisme... À défaut de convaincre, la confiance est là. Accueilli en enfant de la famille il retrouve ce « père adoptif », maître à penser qu’il cherchera à imiter toute sa vie. Acclamé par la population tout au long de son séjour, médiateur entre les chefs indiens et ses hôtes, Lafayette reçoit les hommages de la nation toute entière et prend possession des terres qui lui ont été offertes en Pennsylvanie. Un acte de naturalisation lui est remis le 28 décembre 1784 dans le Maryland : il lui confère, ainsi qu’à son fils et à tous ses descendants mâles, le titre de citoyen des États-Unis à vie.
Toujours soucieux de ne rien laisser passer lorsqu’il
s’agit de nouveauté, Lafayette s’empresse d’adhérer
à la théorie du magnétisme animal et de signer
son engagement dans le mouvement le 5 avril 1784.
Selon les termes de Robert Darnton, il incarne « la
tendance radicale du mesmérisme » qui voulait
« recréer l’homme naturel » et régénérer la France
en « détruisant les obstacles qui s’opposent à
l’harmonie universelle. »
En 1784, il écrit à George Washington : « un
docteur allemand nommé
Mesmer, ayant fait la
plus grande découverte sur le magnétisme animal,
a formé des élèves, parmi lesquels votre humble
serviteur est appelé l’un des plus enthousiastes. »
Cadeaux offerts à Lafayette
au cours de ses différentes
rencontres avec les tribus
d’Amérique.
Carte extraite d’un album constitué par
Charles-Rosalie de Rohan-Chabot, regroupant onze cartes du monde et des continents : l’Europe, l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Golfe du Mexique, l’Amérique centrale, l’Inde, planisphère, le département de la Moselle.
Vue de la maison des Hancock, lieu de
résidence de Lafayette lors de ses séjours à
Boston en 1779 et 1784
« Demain à la pointe du jour je partirai pour Albany, et après avoir fumé le calumet d’amitié
avec toutes les hordes sauvages j’irai revoir mes bons et solides amis de la Nouvelle-Angleterre... »
rapporte Lafayette à Adrienne dans une lettre datée du 15 septembre 1784
A peine revenu d’Amérique, Lafayette demande à Louis XVI de rendre leurs droits civiques aux protestants que la révocation de l’Édit de Nantes avait placés en dehors de la légalité : « Que votre majesté s’inspire du plus populaire de ses aïeux, le roi Henri IV. »
L'année qui suit son retour, Lafayette se rend en Prusse pour assister aux revues et
aux soupers du grand Frédéric. Il voyage ensuite à Vienne où son oncle, le
marquis de Noailles, ambassadeur de France, le présente à Joseph II, puis il
regagne Paris par la Hollande.
En France, la cour lui témoigne toujours sa faveur. En juin 1786, le roi le ramène dans son carrosse de Cherbourg à Paris, après une inspection du port
où
il avait accompagné le ministre de la Marine. L’automne suivant, Lafayette
se précipite à Fontainebleau où la cour réside.
Miniature
représentant Adrienne
de Lafayette accoudée à
une table de tric-trac
Peu de temps après cette intervention, Lafayette entreprend un voyage dans le midi où il enquête sur la situation des protestants français. Il se rend à Nîmes où se tient la plus importante communauté protestante du royaume. Des membres de la société parisienne s'étonnent de voir, au salon de Madame de Lafayette, des pasteurs et des membres de l’Église réformée.
La noblesse locale lui ayant proposé l’acquisition du marquisat de Langeac, Lafayette achète, en avril 1786, la commune pour 188 000 livres et devient marquis de Langeac. Il prend possession de son domaine monté sur un cheval blanc. Cette arrivée et la remise des clés de la ville sont encore célébrées chaque année, deux jours durant, dans une reconstitution d’époque lors de la fête de « la belle journée. »
Langeac attise alors la volonté de Lafayette de mettre les idées des Lumières en application dans ses terres auvergnates. Par ses actions en faveur de l’ouverture de nouvelles voies de communications, du développement de petites industries de transformation des laines de moutons, il concrétise l’idée physiocratique qui veut que le dynamisme économique des campagnes garantisse l’égalité des individus.
Lafayette est aussi l’un des premiers Français à se consacrer à la cause
anti-esclavagiste. Avec l’aide de son épouse Adrienne, il veut mener une
« expérience d’émancipation progressive » d’esclaves. Le couple
acquiert en décembre 1786 une plantation à Cayenne, la Gabrielle,
et en confie le soin, sous la direction d’Adrienne, à un ingénieur
géographe recommandé par
Condorcet, Henri de
Richeprey.
« Je vais travailler à affranchir mes nègres, expérience
qui est, vous le savez, mon rêve favori. » écrit Lafayette
à Washington au lancement de son entreprise.