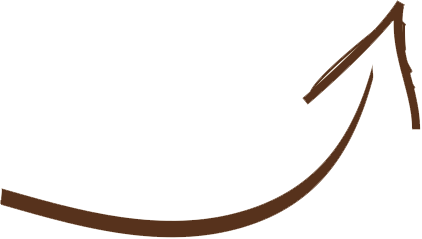
Sitôt rentré à Paris, Lafayette est reçu triomphalement à la cour le 22 janvier 1782. Le roi le réintègre dans l’armée
française avec le grade de Maréchal des camps, à dater du 19 octobre 1781, jour de la capitulation de Yorktown.
« L’opinion l’adopta, l’Opéra l’applaudit, les
actrices le couronnèrent. La reine lui sourit,
le roi le fit général, Franklin le fit citoyen,
l’enthousiasme national en fit son idole. »
Alphonse de Lamartine,
Histoire des Girondins,
Paris, Furne et Coquebert,
1848, t.1, p. 37
Le 8 juin, lors des fêtes données à Versailles en
l’honneur du comte du Nord, le futur Tsar Paul 1er,
elle danse un quadrille avec lui. »
Etienne Taillemite,
La Fayette,
Paris, Fayard,
1989, p. 98
revenait d’Amérique et le
général représentait à la fois
les triomphes du présent et
les espérances de l’avenir...
C’était donc plus qu’une
personne, c’était une idée
que l’on acclamait dans
Lafayette et il le sentait. »
Jules Germain Cloquet,
Souvenirs sur la vie privée
du général Lafayette, Paris,
Galignani et Cie., 1836
« G.(al) Lafayette / le héros des deux mondes. » Thiébault, Jean-Baptiste , Graveur, Lacour, P.,
Imprimeur. Paris Musées / Musée Carnavalet
Marie-Antoinette, reine de
France, d’après Madame
Vigée Lebrun
du public qui le portent aux nues, le « héros
des deux mondes » renoue sa liaison avec
Aglaë de Barbentane, comtesse d’Hunolstein
et conquiert le cœur de Diane-Adélaide de
Damas d’Antigny, de Simiane, célèbre
beauté du moment.
Durant les années qui suivent son retour
triomphal, Lafayette cultive sa popularité et
se consacre avec assiduité à son nouveau rôle :
celui d’un véritable représentant européen des
intérêts américains.
œuvre pour développer le commerce avec
les Etats-Unis, il s’applique à entretenir
l’amitié franco-américaine et à développer
les échanges. Après sa rencontre avec les
députés de commerce de Bayonne il suggère à
Vergennes d’attirer les négociants américains
dans les ports français et obtient l’ouverture
des ports francs de Marseille, Bayonne,
Dunkerque et Lorient.
Vie de Madame de Lafayette par Madame de Lasteyrie,
sa fille, Paris, Techener, 1868.
(en référence à l’État natal de Washington) qui épousera le
marquis de Lasteyrie en 1803.
Lafayette rejoint Chavaniac en mars 1783.
la situation, il découvre sur place la pauvreté engendrée par les
mauvaises récoltes. Plutôt que de vendre le seigle produit sur son
domaine, il le distribue gratuitement aux pauvres.
il reçoit, des mains de son beau-père le
duc d’Ayen, la croix de chevalier de Saint-
Louis, plus haute distinction du régime, au
regard du rôle exceptionnel qu’il a tenu en
Amérique, auprès du Congrès, ainsi qu’en
France, auprès du Roi.
Bourbon, étant prêt à l’accueillir, il quitte
l’hôtel des Noailles avec sa famille, ouvre sa
porte aux représentants de l’esprit nouveau et
réserve un accueil particulier aux américains
de passage à Paris.
réalité des Etats-Unis que
Lafayette s’est peu à peu rallié
aux droits de l’homme. Ces
changements étaient déjà en
France largement introduits par
Rousseau. Nombreux étaient
ceux qui, à l’image du jeune
général, voulaient faire passer
le contrat social de la théorie
à la pratique politique, et
réformer le monde sous le
feu d'idées nouvelles.
France ou se déplace en Auvergne, Lafayette s’entretient
de tout et se montre curieux de la moindre innovation.
Il soutient bon nombre d’exploits dont celui des frères
Montgolfier, inventeurs de la montgolfière, à bord de laquelle
s’effectue, en 1783, le premier vol d’un être humain.
“Unissons-nous pour acheter une petite propriété où nous puissions essayer d’affranchir les Nègres et les employer seulement comme des ouvriers de ferme. Un tel exemple, donné par nous, ajoutait-il, pourrait être généralement suivi, et si nous réussissions en Amérique, je consacrerais avec joie une partie de mon temps à mettre cette idée à la mode dans les Antilles, Si c’est un projet bizarre, j’aime mieux être fou de cette manière que d’être jugé sage pour une conduite opposée.” »
Albert Krebs, La Fayette et l’abolition de l’esclavage, Paris, Cahiers français, 1957.